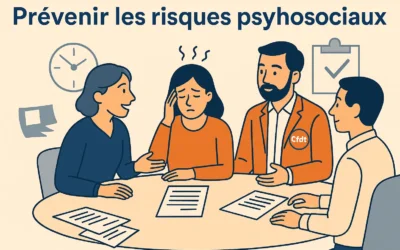Depuis le 1er septembre 2025, la retraite progressive est ouverte dès 60 ans. Une avancée obtenue par la CFDT pour les salariés et agents publics.
Depuis le 1er septembre 2025, un nouveau droit est entré en vigueur : la retraite progressive est désormais accessible dès 60 ans. Derrière cette évolution législative, il y a des années de revendications syndicales, portées avec constance par la CFDT. Pour beaucoup de salariés et d’agents publics, cette possibilité ouvre enfin une perspective : celle de préparer la fin de carrière autrement, de réduire son temps de travail sans basculer brutalement dans la retraite, et de gagner en liberté de choix.
Ce droit n’est pas tombé du ciel. Il est le fruit du dialogue social, mené d’abord dans les négociations sur l’emploi des seniors à l’automne 2024, puis confirmé au printemps 2025 lors du Conclave sur les retraites. Alors que la réforme de 2023 avait repoussé l’âge légal de départ et cristallisé la colère de nombreux travailleurs et travailleuses, la CFDT a maintenu le cap : obtenir des mesures concrètes pour améliorer la situation des seniors en emploi, protéger leur santé et sécuriser leur parcours professionnel.
L’ouverture de la retraite progressive à 60 ans est donc une victoire importante. Mais elle est aussi un point de départ : un dispositif qui doit être connu, compris, utilisé, et encore amélioré pour devenir un véritable droit opposable. C’est dans cet esprit que la CFDT informe, accompagne et continue de revendiquer, afin que chaque salarié puisse bénéficier de cette avancée sans obstacle inutile.
1. Retour sur un contexte de tensions sociales
Pour comprendre la portée de cette avancée, il faut revenir quelques années en arrière. La réforme des retraites de 2023 a marqué un tournant. En repoussant l’âge légal de départ, elle a profondément bouleversé les trajectoires professionnelles et suscité une vague de contestations sociales sans précédent. Pour beaucoup de salariés, travailler plus longtemps signifiait surtout travailler plus usés, avec des perspectives d’emploi fragilisées et des carrières marquées par la pénibilité.
Dans ce climat tendu, une question a pris de plus en plus de place : comment mieux accompagner les seniors au travail ? La CFDT n’a cessé de rappeler que repousser l’âge légal ne suffit pas si l’on n’améliore pas l’emploi des seniors, qui reste un maillon faible du marché du travail en France. Trop souvent, les salariés de plus de 55 ans se retrouvent écartés des opportunités, confrontés au chômage de longue durée ou à des conditions de travail dégradées.
C’est dans ce contexte qu’a été ouverte, à l’automne 2024, une négociation nationale interprofessionnelle sur l’emploi des seniors. La CFDT y est entrée avec une revendication claire : obtenir des solutions concrètes pour que les fins de carrière soient vécues autrement que comme une course d’obstacles. La retraite progressive a été au cœur de ces discussions, portée comme une alternative crédible et humaine.
L’année suivante, lors du Conclave retraites de 2025, cette revendication a trouvé un écho. Face à la nécessité de rééquilibrer un système contesté et de répondre à la colère sociale, le gouvernement a validé l’élargissement du dispositif, en l’ouvrant dès 60 ans et en l’étendant à l’ensemble des salariés et agents publics.
Autrement dit, cette mesure n’est pas seulement technique : elle est née d’un moment de tensions sociales fortes, où la CFDT a su transformer la contestation en négociation, et la négociation en droit nouveau.
2. La retraite progressive : de quoi parle-t-on ?
La retraite progressive n’est pas une nouveauté, mais son extension à partir de 60 ans change profondément la donne. Ce dispositif permet à un salarié de réduire son temps de travail en fin de carrière tout en percevant une partie de sa pension de retraite, proportionnelle au temps libéré.
Concrètement, cela signifie qu’au lieu de travailler à temps plein jusqu’au jour du départ à la retraite, puis de basculer du jour au lendemain dans l’inactivité, il devient possible de préparer en douceur la transition. Le salarié continue à exercer son métier, mais avec un rythme allégé, et voit son revenu complété par une fraction de sa pension.
Prenons deux exemples simples :
- Un salarié passe à 60 % de temps de travail : il percevra 40 % de sa pension en complément de son salaire.
- Un salarié réduit son activité à 50 %: il touchera 50 % de sa pension.
Ce système présente deux avantages majeurs :
- Le salarié garde un lien avec le travail (donc un revenu, une protection sociale, un rôle professionnel) tout en ayant plus de temps pour soi, sa famille, sa santé.
- Il continue de cotiser pour sa retraite future : la pension définitive, calculée au moment du départ complet, n’est donc pas figée et peut encore évoluer.
La retraite progressive, c’est en quelque sorte un pont entre la vie active et la retraite. Elle évite la coupure brutale, souvent difficile à vivre, et répond à une aspiration grandissante : ne pas subir sa fin de carrière, mais pouvoir la gérer à son rythme.
Pour la CFDT, c’est un dispositif d’avenir : il répond à la fois aux enjeux de santé au travail, de transmission des compétences aux plus jeunes, et de liberté individuelle dans la manière de finir sa vie professionnelle.
3. Le nouveau cadre légal depuis septembre 2025
Depuis le 1er septembre 2025, les règles de la retraite progressive ont été harmonisées et assouplies grâce à deux décrets publiés au Journal officiel le 23 juillet 2025. Ces textes – les décrets n° 2025-680 et n° 2025-681 – fixent les conditions d’accès au dispositif pour l’ensemble des régimes, qu’il s’agisse du secteur privé ou de la fonction publique.
Un droit ouvert à partir de 60 ans
Désormais, tout salarié ou agent public peut demander à bénéficier de la retraite progressive dès 60 ans, alors que l’âge minimum variait auparavant selon l’année de naissance (entre 60 et 62 ans). C’est un changement majeur : l’âge d’accès est désormais unique et plus lisible.
Les conditions à remplir
Pour bénéficier de ce dispositif, trois critères principaux sont requis :
- Avoir 60 ans révolus.
- Justifier de 150 trimestres validés dans les régimes de retraite de base (soit 37,5 années de cotisations).
- Exercer une activité à temps réduit, comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail.
À ces conditions s’ajoute un point important : le passage à temps partiel doit obtenir l’accord de l’employeur. Désormais, le refus doit être motivé par écrit, ce qui constitue un progrès, même si cela ne rend pas encore le droit opposable.
Un dispositif étendu à tous les régimes
Les décrets de juillet 2025 précisent que le dispositif s’applique :
- aux salariés du régime général et des régimes spéciaux,
- aux salariés et non-salariés agricoles,
- aux professions libérales et aux avocats,
- aux agents publics : fonctionnaires d’État, territoriaux, hospitaliers, ainsi que les contractuels.
Cette extension à la fonction publique était une revendication de longue date, que la CFDT a portée jusqu’au bout. Désormais, le droit à la retraite progressive est universel, quelle que soit la branche d’activité ou le statut.
Une demande encadrée dans le temps
La demande doit être effectuée auprès de l’Assurance retraite (ou de la caisse compétente selon le régime) cinq mois avant la date prévue de passage en retraite progressive. Le salarié doit fournir :
- l’accord de l’employeur sur le temps partiel,
- les justificatifs de carrière,
- et préciser la quotité de travail souhaitée.
En cas d’accord, la pension partielle est versée dès l’entrée en vigueur du temps réduit.
4. Ce que cela change pour les salariés
L’ouverture de la retraite progressive dès 60 ans n’est pas une simple réforme technique : c’est une bouffée d’oxygène pour de nombreux salariés qui, jusqu’ici, se retrouvaient contraints de travailler à temps plein dans les dernières années de leur carrière, parfois au prix de leur santé.
Un meilleur équilibre de fin de carrière
Pouvoir réduire son temps de travail tout en percevant une partie de sa pension, c’est la possibilité de souffler après des décennies d’activité. Beaucoup de salariés approchant de la soixantaine cumulent fatigue, problèmes de santé ou contraintes familiales (soutien à un proche, petits-enfants à garder). La retraite progressive leur offre un cadre légal pour alléger leur charge sans être pénalisés financièrement comme dans un temps partiel « classique ».
Une alternative au chômage ou à l’inactivité forcée
Trop souvent, les salariés seniors sont poussés vers la sortie : licenciements économiques, ruptures conventionnelles, contrats précaires ou chômage de longue durée. La retraite progressive change la perspective : au lieu d’être exclus du marché du travail, les salariés peuvent rester actifs mais à un rythme adapté, en continuant à accumuler des droits pour leur retraite définitive.
Un outil de transmission et de reconnaissance
En permettant aux plus expérimentés de rester partiellement présents, le dispositif favorise aussi la transmission des savoirs vers les plus jeunes. Plutôt que de couper brutalement le lien, l’entreprise conserve l’expertise de ses anciens, et les salariés partants ont l’occasion de valoriser leurs compétences.
Une liberté de choix retrouvée
Ce qui change profondément, c’est la possibilité pour chacun d’aménager sa fin de carrière selon ses besoins. Certains choisiront de travailler à 70 ou 80 % pour garder un fort ancrage professionnel, d’autres préféreront descendre à 50 % pour se consacrer davantage à leur vie personnelle. Dans tous les cas, c’est un droit qui redonne une part de maîtrise sur son parcours.
5. Les limites actuelles du dispositif
Si l’ouverture de la retraite progressive à 60 ans est une avancée, il serait illusoire de croire que tout est réglé. Les décrets de juillet 2025 ont clarifié les règles et élargi le dispositif, mais plusieurs freins subsistent dans la pratique.
L’accord de l’employeur reste indispensable
Pour les salariés du privé, le passage à temps partiel doit toujours obtenir l’aval de l’employeur. Certes, la loi impose désormais que le refus soit motivé par écrit, mais cela ne transforme pas pour autant ce droit en un droit opposable. En clair, un salarié peut encore se voir refuser son projet si l’entreprise estime que son absence à temps plein perturberait l’organisation. Ce pouvoir de blocage reste un obstacle majeur.
Des conditions restrictives
Le seuil des 150 trimestres validés peut constituer une barrière pour les carrières hachées, notamment celles des femmes, des temps partiels subis ou des personnes ayant connu des périodes de chômage. De même, la fourchette imposée (40 à 80 % d’un temps complet) ne couvre pas toutes les situations : certains salariés auraient besoin de descendre en dessous de 40 %, mais la loi ne le permet pas.
Un dispositif encore trop méconnu
Beaucoup de salariés ignorent encore l’existence ou le fonctionnement de la retraite progressive. Certains pensent qu’il s’agit d’une préretraite, d’autres craignent une baisse irréversible de leur pension. Le manque d’information claire et accessible constitue un frein réel à l’utilisation de ce droit.
Des inégalités persistantes
Enfin, tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Dans certaines grandes entreprises, la retraite progressive peut être encouragée comme outil de gestion des carrières. Mais dans de petites structures ou dans des secteurs où les effectifs sont tendus, la direction est parfois réticente à accepter des temps partiels en fin de carrière. Résultat : selon l’employeur, le même droit peut être plus ou moins accessible.
6. La position et les revendications de la CFDT
Pour la CFDT, l’ouverture de la retraite progressive dès 60 ans est une victoire syndicale majeure. Elle montre qu’avec la négociation et le dialogue social, il est possible d’arracher des droits concrets qui améliorent la vie des salariés. Après des années de revendications et plusieurs mois de discussions intenses, ce dispositif est devenu une réalité, accessible à l’ensemble des travailleurs et travailleuses, qu’ils soient salariés du privé ou agents publics.
Mais la CFDT ne s’arrête pas là. Si l’avancée est réelle, elle doit maintenant être consolidée et élargie. Trois revendications principales demeurent au cœur de son action :
1. Faire de la retraite progressive un droit opposable
Aujourd’hui, l’employeur peut encore s’opposer à une demande, même s’il doit justifier son refus. Pour la CFDT, cette possibilité entretient une inégalité et un sentiment d’arbitraire. Le syndicat demande que la retraite progressive devienne un droit opposable, c’est-à-dire que chaque salarié qui en remplit les conditions légales puisse en bénéficier sans dépendre du bon vouloir de sa direction.
2. Élargir les conditions d’accès
La CFDT souhaite que le seuil des 150 trimestres soit réexaminé pour ne pas exclure ceux dont les carrières sont incomplètes, souvent les plus fragilisés (emplois précaires, temps partiel subi, interruptions liées à la maternité ou au chômage). Le dispositif doit profiter à toutes et tous, et non seulement à ceux qui ont eu des parcours stables.
3. Mieux informer les salariés
Enfin, la CFDT insiste sur la nécessité d’une information claire et accessible. Beaucoup de salariés ignorent encore ce qu’est la retraite progressive ou la confondent avec une préretraite. La CFDT demande que l’État, les caisses de retraite et les employeurs s’engagent dans une campagne massive d’information, et s’emploie de son côté à relayer largement ces droits auprès des salariés.
La retraite progressive accessible dès 60 ans marque une avancée sociale indéniable. Elle apporte une réponse concrète aux salariés et aux agents publics qui ne veulent plus subir une fin de carrière usante et brutale. Elle leur offre un nouvel espace de liberté : travailler autrement, transmettre leur savoir, préserver leur santé, tout en préparant sereinement leur départ à la retraite.
Mais cette avancée reste incomplète. Tant que le dispositif ne sera pas un droit opposable, tant que des salariés continueront de se voir refuser leur demande pour des motifs organisationnels, tant que les carrières incomplètes resteront exclues, la CFDT ne considérera pas le chantier terminé.
CFDT UES Brioche Dorée